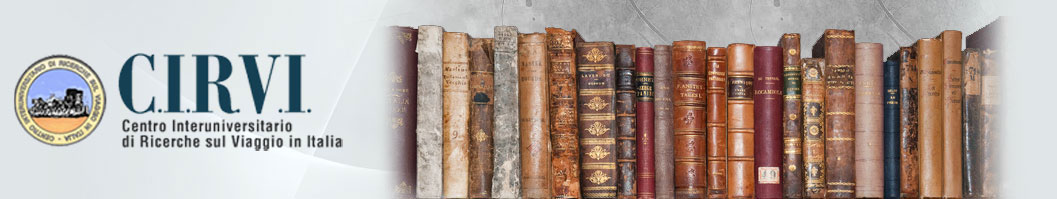Voyages en Italie (1603-1612).
BVI 71

Pierre BERGERON N
Voyages en Italie (1603-1612).Édition et notes par Luigi MONGA.
Biblioteca del Viaggio in Italia «Testi»
pp. 366
ISBN 88-7760-071-7.
35.00 €
Le problème principal de la chronologie de ce voyage reste l’antinomie entre un itinéraire qui se voudrait réel et l’insertion de données tirées d’événements successifs au même voyage. Le récit de voyage est ainsi greffé sur des données irréelles, ou du moins sur des anachronismes: seul le lecteur peu averti pourrait lire cette Relation d’Italie sans se rendre compte des contradictions fondamentales qu’elle renferme. Cela revient à clarifier per absurdum, on dirait, une fois de plus la méthode de Bergeron: son voyage réel n’est que le support sur lequel l’auteur a voulu bâtir une description de l’Italie, un guide à la connaissance objective d’un pays que l’auteur connaissait bien. Ce manuscrit de Bergeron me semble se situer dans le sillon de certains textes hodéporiques contemporains – ou, plutôt, des descriptions de régions particulières, notamment celles de Leandro Alberti, de Louis Coulon et de Philipp Clüver – des textes ayant le but spécifique de recueillir avant tout des renseignements objectifs, surtout historiques et littéraires, sur les endroits visités. Le récit du voyage, les détails mêmes du déplacement du narrateur, disparaissent devant la masse considérable des détails glanés dans les sources classiques ou pillés dans les auteurs contemporains. Déjà Pétrarque avait essayé d’escamoter le récit d’un voyage en Terre Sainte qu’il n’avait pas osé entreprendre à cause de sa phobie pour les voyages en mer, mais le XVIe siècle s’enrichit de récits de voyages qui privilégient ce détail historique, la description objective du lieu, la collection des inscriptions et des chef d’œuvres de l’art, avec une présence superficielle du moi qui raconte au lecteur le développement de l’action. Ce sujet narrant est un vague nous qui sous-entend un groupe de voyageurs souvent non identifiés. Le texte de Bergeron, très éloigné d’une tentative de narration d’un voyage personnel, représente donc un moment d’objectivité dans la collection des éléments dignes d’être rappelés à la postérité (et c’est bien la citation «haec olim meminisse juvabit» de Virgile que Bergeron inscrit en épigraphe à son manuscrit). Et l’abondance des renseignements que l’auteur offre à son lecteur nous rappelle l’appréciation de Giovanni Antonio Flaminio pour la richesse des beaux détails («pulchritudo et copia») qu’il avait remarqués dans son introduction à la Descrittione de Leandro Alberti: un texte où la curiositas de son auteur l’emporte sur les détails personnels que chercherait dans un texte hodéporique le lecteur du deuxième millénaire.